Thread : les origines et les transformations du mouvement kawaii
Comment un mouvement, à l’origine féministe et contestataire, s’est fait ravaler par l’idéologie néolibérale qui en a effacé les principes initiaux pour en faire un business.
Un thread de @NunyaFR
Dictionnarisé en 2018, « kawaï » trône désormais aux côtés de « manga », « tsunami » et autre « emoji ». Mais sa définition masque son origine contestataire et sa spectaculaire récupération par le néolibéralisme japonais.
🎀 Un thread tout en froufrous et en paillettes 🎀 pic.twitter.com/pwDu14uTwn
— Lex Tutor (@NunyaFR) July 17, 2022
Difficile de parler du mouvement kawaï, sans aborder en amont l'évolution sémantique de l'adjectif « kawaii » (可愛い). Etymologiquement, « kawaii » est la contraction de « kahohayushi » (顔映ゆし), une expression utilisée pour décrire son rougissement, sa gêne ou son embarras.
— Lex Tutor (@NunyaFR) July 17, 2022
Le sens glisse progressivement pour décrire un sentiment d’empathie ou de pitié, puis pour dépeindre les personnes mêmes pour lesquelles ces sentiments sont ressentis – à l'époque, surtout les femmes et les enfants.
On ne se sent plus kawaii, c'est les autres qui le sont.— Lex Tutor (@NunyaFR) July 17, 2022
À l’époque d’Edo (1603–1868), le changement de la représentation des femmes dans un contexte néo-confucianiste va donner à « kawaii » de nouvelles propriétés. L’autre est kawaii parce qu'on a de l'empathie ou de la pitié pour sa fragilité, sa délicatesse, sa sensibilité. pic.twitter.com/3jcUv0q7qB
— Lex Tutor (@NunyaFR) July 17, 2022
Au fil du temps, la connotation de pitié s’estompe au profit de l’amour. Vers la fin de l'époque d'Edo, on est kawaii parce qu’on est aimable, ou parce qu'on est adorable.
Mais si la connotation de pitié s'est estompée, elle n'a pas pour autant disparu.— Lex Tutor (@NunyaFR) July 17, 2022
Dans la langue actuelle, « kawaisou » (かわいそう) est utilisé lorsque quelqu'un/quelque chose nous inspire de la pitié/compassion. « Kawaigaru » (可愛がる) joue sur sa polysémie : il s'agit autant de traiter quelqu'un comme kawaii que d'agresser en groupe un subordonné (😭).
— Lex Tutor (@NunyaFR) July 17, 2022
Repartons un peu dans le passé. Au début du XXᴱ siècle, le Japon entre dans une période de modernité. Avec l’ouverture du pays en 1868 et les débuts de la culture de masse, les jeunes femmes, « shoujo » (少女), deviennent des entités sociales à part entière. pic.twitter.com/stwo4rQ1gs
— Lex Tutor (@NunyaFR) July 17, 2022
À la fin de la Seconde Guerre mondiale, alimentées par une forte volonté d’émancipation, les jeunes générations aspirent à de nouveaux droits et à de nouvelles libertés, et l'expriment par les manifestations, la musique contestataire… mais aussi par l’écriture.
— Lex Tutor (@NunyaFR) July 17, 2022
(à ce propos, l'écriture de ce genre de threads prenant un temps fou, un petit partage et un petit follow, ça fait toujours plaisir 😭🙏)
— Lex Tutor (@NunyaFR) July 17, 2022
Au début des années 70, dans les écoles, les adolescentes s’inspirent de la police de caractère « nar » utilisée dans certains magazines féminins pour inventer une écriture aux 𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 lettres exagérément rondes : les maruji.
C'est le début de la culture kawaï. pic.twitter.com/RDCPaj0tpd— Lex Tutor (@NunyaFR) July 17, 2022
En infantilisant leurs lettres, les jeunes femmes se moquent de la rigueur de l’écriture japonaise en rejetant l’idéal de la bonne épouse-mère en vogue durant la guerre.
Puisque sortir de l’enfance impose de se plier à une maturité sacrificielle, alors elles n’en sortiront pas.— Lex Tutor (@NunyaFR) July 17, 2022
De nombreuses écoles interdisent l’utilisation des lettres rondes. En vain. Rapidement, cette rébellion graphologique va s’accompagner d’un contrôle de plus en plus actif des femmes sur leur propre culture. La Grande-Bretagne a son youthquake, le Japon aura son kawaiiquake. pic.twitter.com/bvQtyBqa7l
— Lex Tutor (@NunyaFR) July 17, 2022
L'écriture ronde gagne le pays et les uniformes scolaires strictement codés se personnalisent, influencés par l’esthétique « cute » euro-américaine, par les films de Disney jusque là interdits, mais aussi par la folle effervescence artistique de l’époque. pic.twitter.com/LuE3fnisY2
— Lex Tutor (@NunyaFR) July 17, 2022
Au cours des années 60, les femmes se réapproprient les shoujo manga, genre à destination du public féminin, aux mains des hommes depuis les années 50. En 1972, la publication de « La Rose de Versailles », inspirée du féminisme de la seconde vague, est un immense succès. pic.twitter.com/tuaIXpEg7h
— Lex Tutor (@NunyaFR) July 17, 2022
La représentation de valeurs révolutionnaires au milieu d’une esthétique baroque dépasse le simple cadre du manga et marque l’esthétisme de toute une génération. Le kawaï devient un mouvement aux influences multiples, au service de la lutte des femmes pour leur émancipation. pic.twitter.com/Gl2VrVyU7w
— Lex Tutor (@NunyaFR) July 17, 2022
Progressivement, les femmes élargissent leur horizon à des domaines monopolisés jusque là par les hommes. Elles font davantage de cinéma, de musique, de théâtre, de roman. C’est l’émergence de la « culture des shoujo », et le Japon connaît un mouvement de libération des femmes. pic.twitter.com/0SlBRFA7Iu
— Lex Tutor (@NunyaFR) July 17, 2022
De plus en plus de créateurs adoptent puis étoffent le kawaï. Pink House (1973), fondée par d’anciens étudiants révolutionnaires, Milk (1970), Shirley Temple (1974) apportent les froufrous, les styles victorien ou édouardien, dont va émerger le célèbre style Lolita. pic.twitter.com/suI7LFkYZ4
— Lex Tutor (@NunyaFR) July 17, 2022
Le succès de l’esthétique kawaï est d’autant plus rapide que le consumérisme hédoniste auquel s’adonnent les jeunes Japonaises est aussi vu comme une façon de mettre à mal l'idéal de la bonne épouse-mère, pilier de rigueur morale et de responsabilité.
— Lex Tutor (@NunyaFR) July 17, 2022
Mais le mouvement kawaï va rapidement devoir composer avec trois variables qui vont atténuer sa force contestataire jusqu’à l’éteindre : la contre-offensive réactionnaire masculine, la reconnaissance de son colossal potentiel commercial, et la mollesse de sa rébellion.
— Lex Tutor (@NunyaFR) July 17, 2022
Une offensive réactionnaire d’abord, lorsque de nombreux universitaires commencent à s’inquiéter de la décadence du Japon qu'emporterait la culture kawaï. Beaucoup y voient une alinéation d’après-guerre et une perte dans le narcissisme. Le mouvement est critiqué, dénigré, moqué.
— Lex Tutor (@NunyaFR) July 17, 2022
La reconnaissance de son potentiel commercial ensuite, amenant de nombreuses marques à s'en emparer pour surfer sur ces nouvelles tendances de consommation.
« Sanrio » crée Hello Kitty en 1974, qui devient rapidement LA mascotte du kawaï. La portée politique passe à la trappe. pic.twitter.com/8ragTbUVOm— Lex Tutor (@NunyaFR) July 17, 2022
La mollesse de sa rébellion enfin, parce que si le kawaï refuse d’entrer dans les valeurs culturelles et esthétiques dominantes, il ne les remet pour autant pas en question. La rébellion sage va rapidement devenir une sage rébellion cooptée par les institutions japonaises.
— Lex Tutor (@NunyaFR) July 17, 2022
Le kawaï devient une culture de masse. Le quartier de Harajuku en devient le bastion symbolique. Toutes les institutions s’offrent des logos, des campagnes publicitaires et des mascottes kawaii.
Regardez Pipo-kun, il n’est pas adorable ?
C’est la mascotte de la police de Tokyo. pic.twitter.com/SxnbIyaU2n— Lex Tutor (@NunyaFR) July 17, 2022
La cooptation progressive de l’Etat dilue le sens politique du kawaï, qui finit de saborder le reste : en retravaillant sans cesse le passé sans agenda politique et dans un désir perpétuel de nouveauté, il se rend parfaitement compatible avec la logique néolibérale.
— Lex Tutor (@NunyaFR) July 17, 2022
Avec le temps, le mouvement se restreint à l’esthétique de la minorité et à ses attraits de dépendance, d’inexpérience, de douceur. Il remplace l'idéal occidental comme standard de beauté. Les idoles, machines publicitaires à la gloire éphémère, cartonnent dans tous les médias. pic.twitter.com/VrgpKuotgO
— Lex Tutor (@NunyaFR) July 17, 2022
La fin de la bulle économique (1990) met un coup d’arrêt à la frénésie de consommation. L’idéal du salarié d’entreprise disparaît, laissant nombre de Japonais angoissés par leur avenir. Le kawaï et ses attraits de dépendance deviennent de plus en plus désirés par les hommes.
— Lex Tutor (@NunyaFR) July 17, 2022
La reprise du kawaï passe aussi par sa sexualisation. Le hentaï présente des filles souvent jeunes et innocentes, et les ventes des uniformes scolaires comme fétiches explosent. Les magazines de charme affichent désormais des jeunes filles en chaussettes longues et en uniforme. pic.twitter.com/wEqlbigUM3
— Lex Tutor (@NunyaFR) July 17, 2022
À contrepied de l'imagerie d'avant-guerre, docilité et dépendance envahissent la pornographie masculine et ce dans toute sa noirceur : on estime en 2007 qu’une scène sur trois est une scène d'abus sexuel.
Le kawaï, à l’origine asexué, devient un moteur de la sexualité masculine.— Lex Tutor (@NunyaFR) July 17, 2022
Il devient aussi progressivement une pression sociale : il faut être kawaii, et le plus longtemps possible. Dans les années 2000, Kuroda Chieko incarne « l’adulte kawaii ». En 1999 le magazine « Sweet » titre : « à 28 ans proclamez être une fille tout le reste de votre vie. » pic.twitter.com/MMw0EkzVT1
— Lex Tutor (@NunyaFR) July 17, 2022
À la sortie de Wonder Woman, Warner Bros Japan présente l’héroïne comme une « femme naïve et innocente qui ne connaît rien des hommes et de l’amour ». La bande annonce est narrée par Kotono Mitsuishi (Sailor Moon), la « crème des voix kawaii ».https://t.co/y7KHJeroa2
— Lex Tutor (@NunyaFR) July 17, 2022
Cette nécessité d’apparaître jeune le plus longtemps possible est d'autant plus forte que l’idée qu’au Japon une femme qui dépasse 30 ans est un « leftover christmas cake » (« pas bonne après le 25 ») s'est imposée dans le champ social.
— Lex Tutor (@NunyaFR) July 17, 2022
Puisque qu’il faut désormais être kawaii toute sa vie – y compris professionnelle – le kawaï a importé les valeurs néolibérales de la société et participe désormais à transformer son éthos selon les valeurs de l’entreprise privée et de l’entreprenariat.
Grâce à sa flexibilité.— Lex Tutor (@NunyaFR) July 17, 2022
C'est cette flexibilité qui présente un potentiel marketing et idéologique puissant et lucratif, capable de s’attacher à une variété de qualités et d’affects différents. C'est aussi cette flexibilité qui rend tout plus bénin, plus attrayant, plus sûr à consommer.
— Lex Tutor (@NunyaFR) July 17, 2022
Le 11 mars 2011, Hachiya Kazuhiko publie une vidéo sur YouTube afin d'atténuer la gravité de Fukushima. La centrale est représentée par l'adorable Genpatsu-kun. Ses pets sont les accidents, et sa couche, la protection à de plus gros dégâts. L'enfer. https://t.co/6N3NT8czaS
— Lex Tutor (@NunyaFR) July 17, 2022
Kyary Pamyu Pamyu, présentée par la BBC comme LE visage du kawaï, fait même la publicité d'un magazine d’emplois précaires. Flexible, on vous dit.
Elle incarne ainsi une culture désormais au croisement subtile et complexe du néolibéralisme, de l’orientalisme et du nationalisme. pic.twitter.com/FDkx5NO8S5— Lex Tutor (@NunyaFR) July 17, 2022
Sa chanson ANAN est édifiante : « défonçons-nous pour travailler dans des jobs précaires », « travaillons pour acheter ce qu'on veut ».
On ne peut plus clair : soyons des travailleurs flexibles dans le processus de production, et de bons consommateurs.https://t.co/NEUDdTvShM— Lex Tutor (@NunyaFR) July 17, 2022
Bien sûr, des résistances se font sentir dans le mouvement (avec des formes plus extrêmes comme le kimokawaii, le gurokawaii), ou en dehors (les yamamba et la culture gyaru), mais la machine est désormais bien huilée, à plus forte raison depuis qu’elle s’est internationalisée. pic.twitter.com/2hBA4VQ8Bj
— Lex Tutor (@NunyaFR) July 17, 2022
En 2009, dans le cadre du « Cool Japan » destiné à produire du soft power japonais en masse, le gouvernement nomme Misako Aoki, Yu Kimura et Shizuka Fujioka ambassadrices du kawaï, qui est alors reconnu mondialement et devient la quintessence historique de l’esthétique japonaise. pic.twitter.com/DR5VrZPVkJ
— Lex Tutor (@NunyaFR) July 17, 2022
La même année, le magazine BRUTUS (ブルータス) titre « la culture des jeunes femmes, elles ont sauvé le Japon ?! » et met l’accent sur leur capacité à s’adapter à la crise et à reconstruire le pays. Montrant au passage le fort lien entre discours nationalistes et néolibéraux.
— Lex Tutor (@NunyaFR) July 17, 2022
La femme kawaii est désormais une femme éternellement jeune, active et travailleuse, qui sait aussi être une épouse et une mère responsable. En étant célébré, le kawaï a progressivement aidé à imposer la logique oppressive en dérision de laquelle il s’était pourtant construit.
— Lex Tutor (@NunyaFR) July 17, 2022
Aujourd’hui, il ne reste plus rien de son aspect contestataire, à part quelques études et de bien trop longs threads Twitter. Les récentes études montrent que la rébellion est désormais un impensé, malgré quelques poches de résistance d'autres groupes marginalisés.
— Lex Tutor (@NunyaFR) July 17, 2022
De nombreux discours féministes actuels soulignent que, désormais, la culture kawaï entretient la domination culturelle et l’exploitation des femmes dans le pays, en encourageant leur soumission, leur innocence et leur faiblesse.
— Lex Tutor (@NunyaFR) July 17, 2022
Selon ces mêmes autrices, aucun paradigme post-kawaï ne pourra émerger tant que la structure culturelle et sociale n’aura perdu de son autorité.
En attendant, le kawaï n’est plus désormais qu’à l’image d’Hello Kitty : sans bouche. pic.twitter.com/mz00DzmAh2— Lex Tutor (@NunyaFR) July 17, 2022

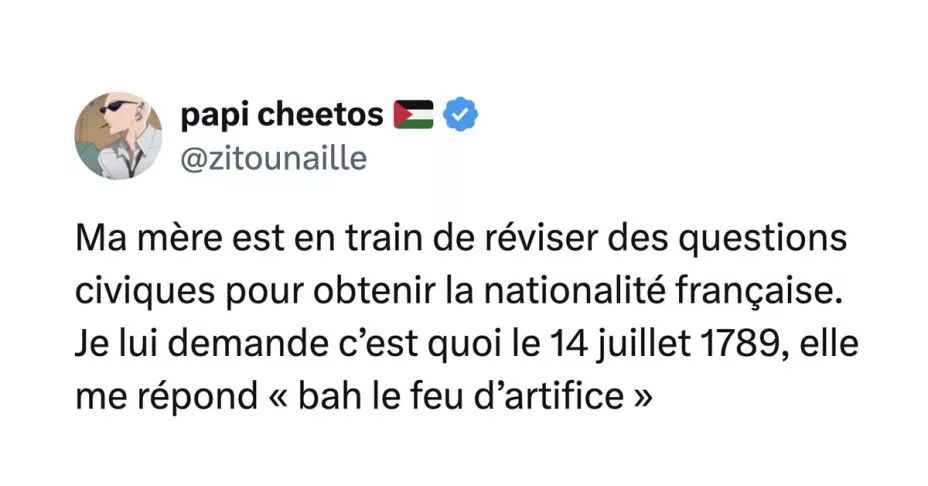
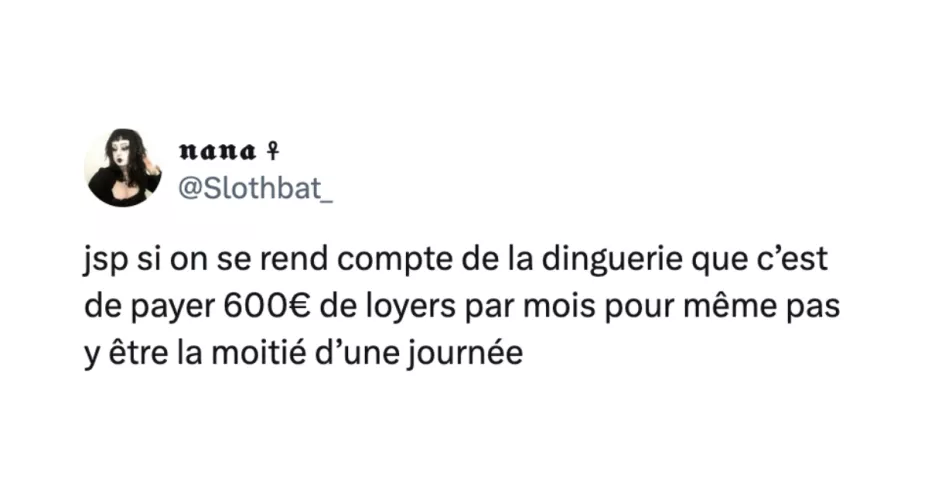
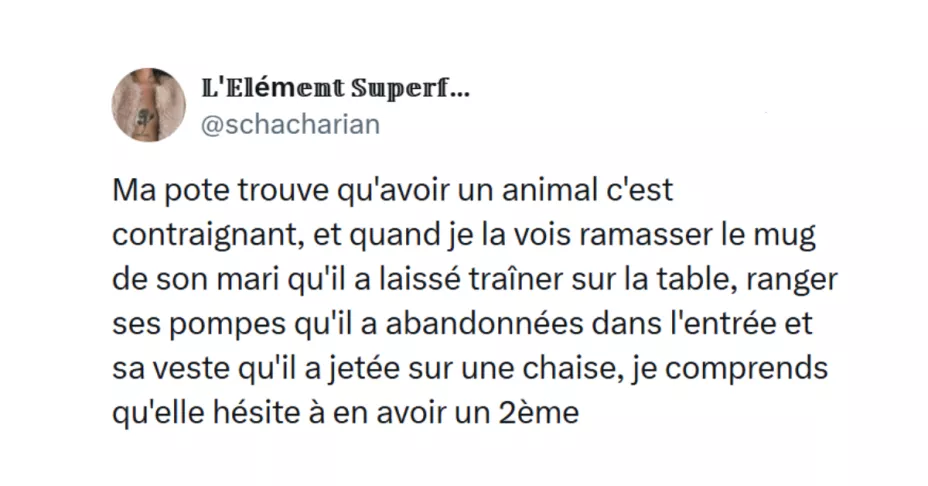
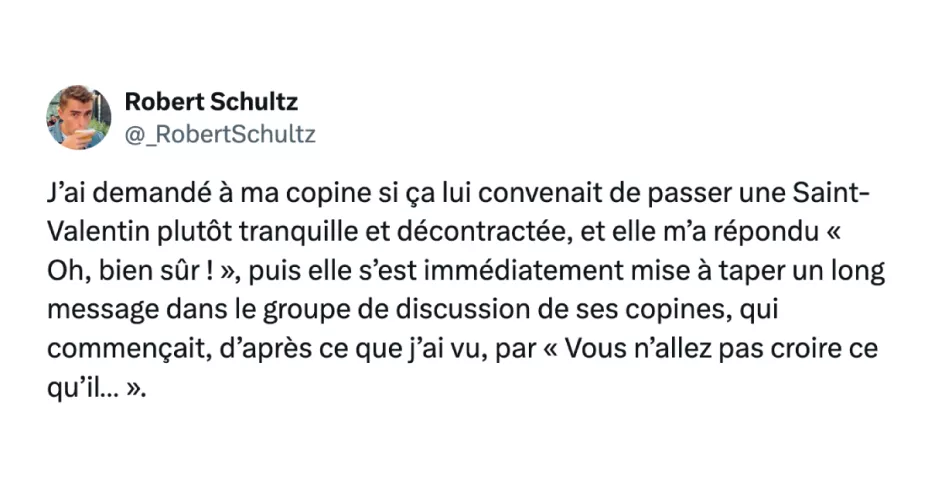
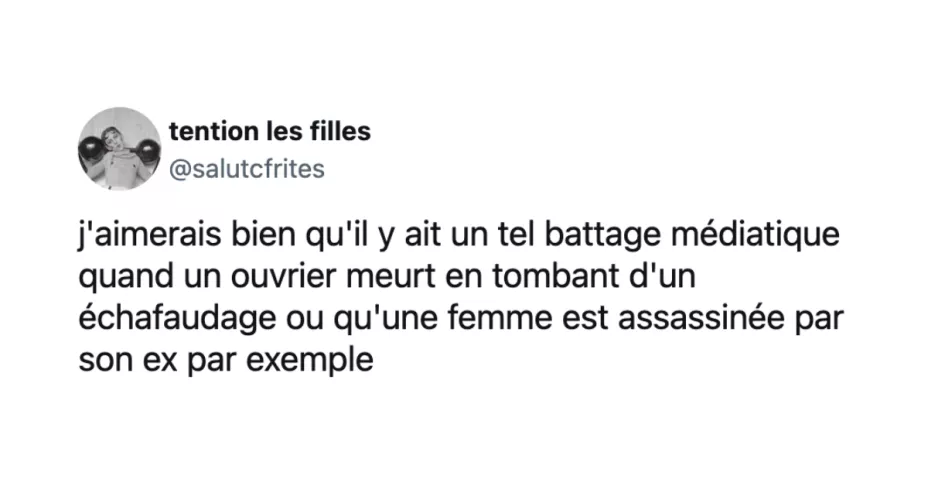
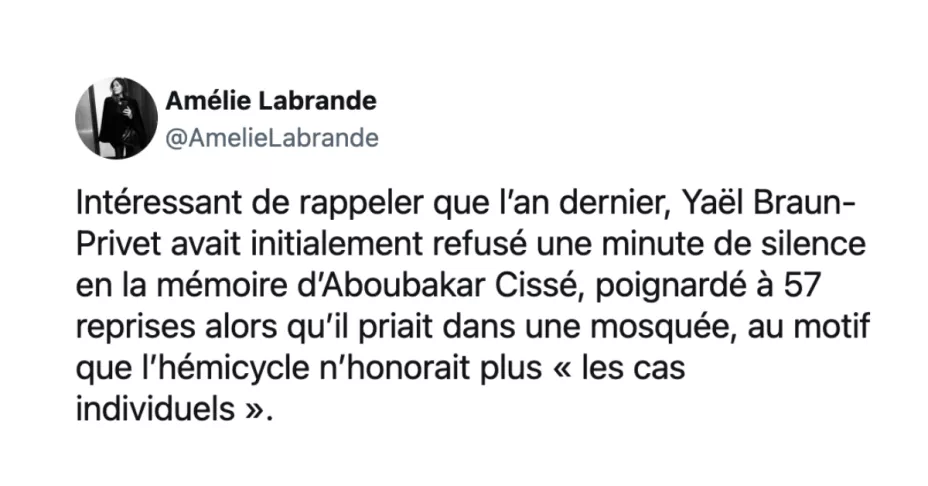
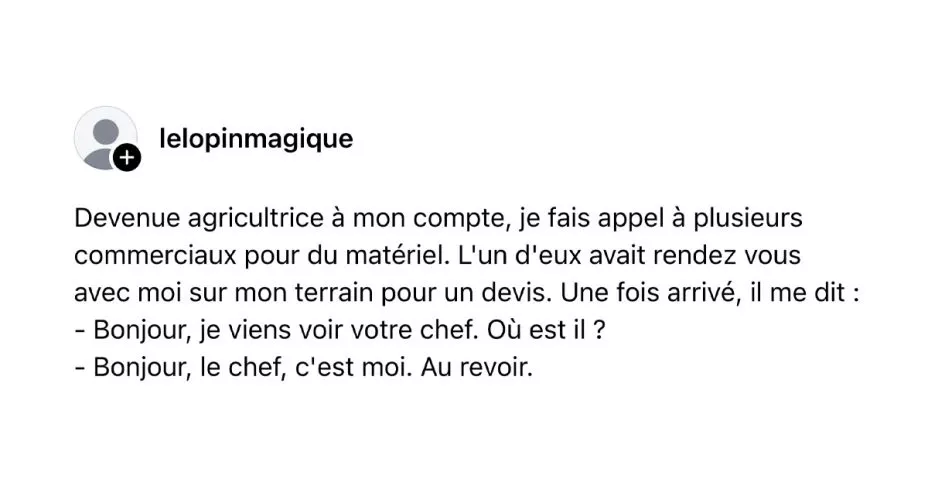
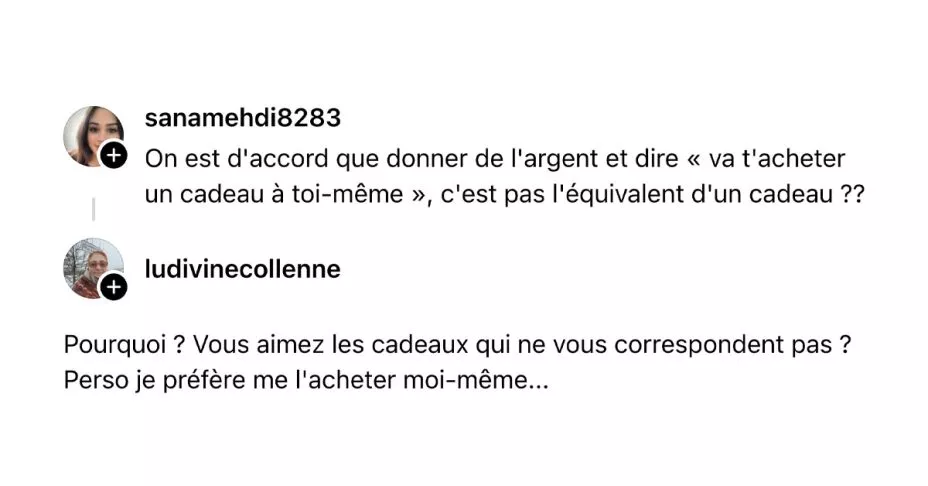
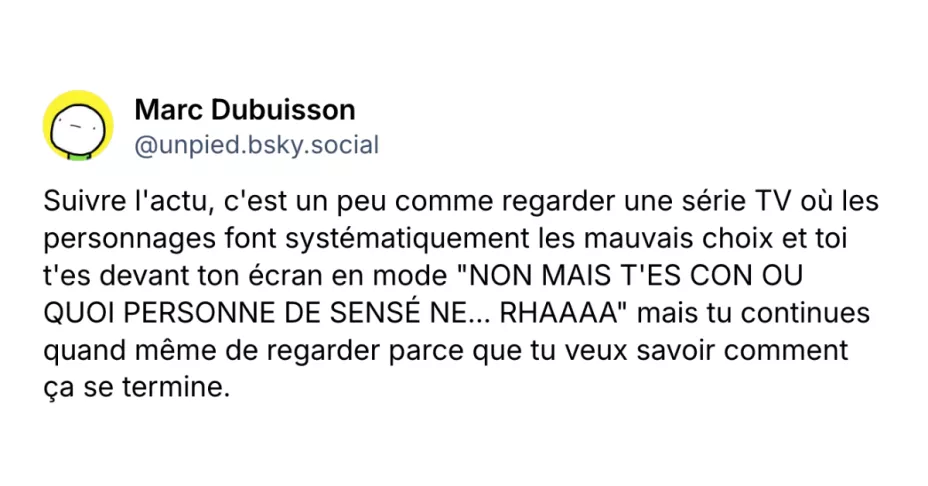
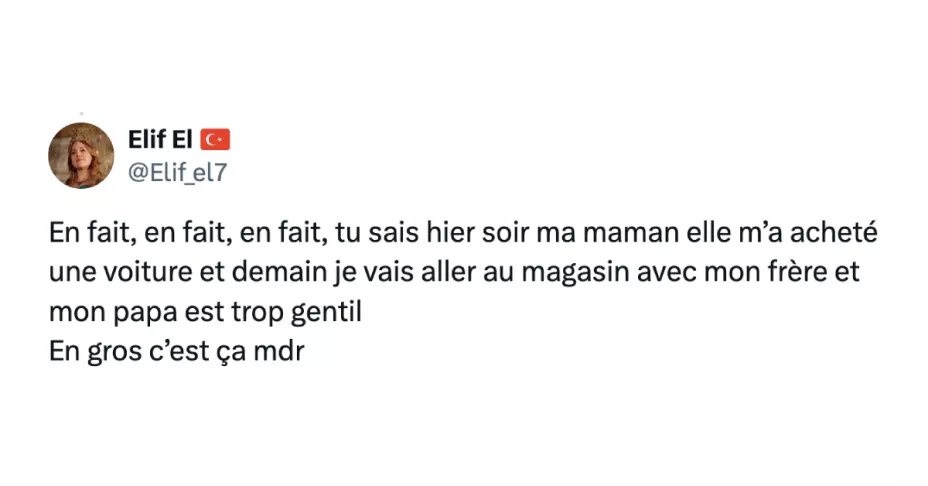
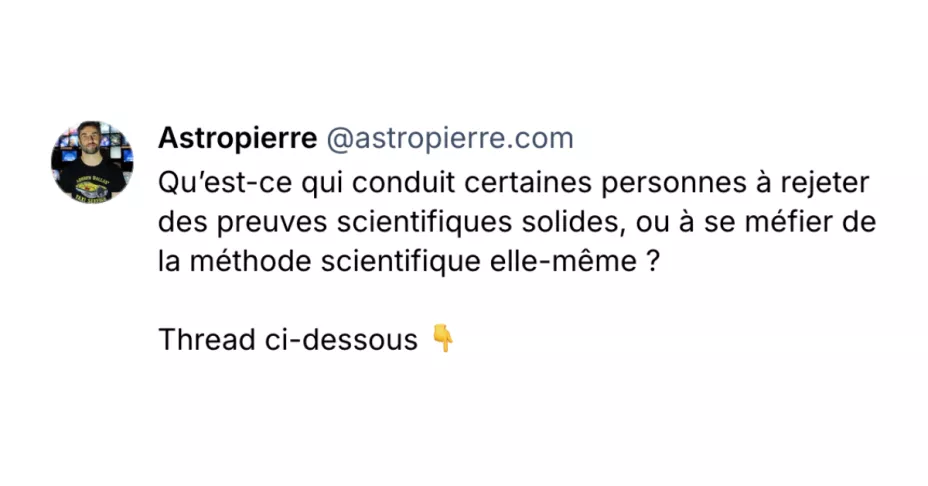
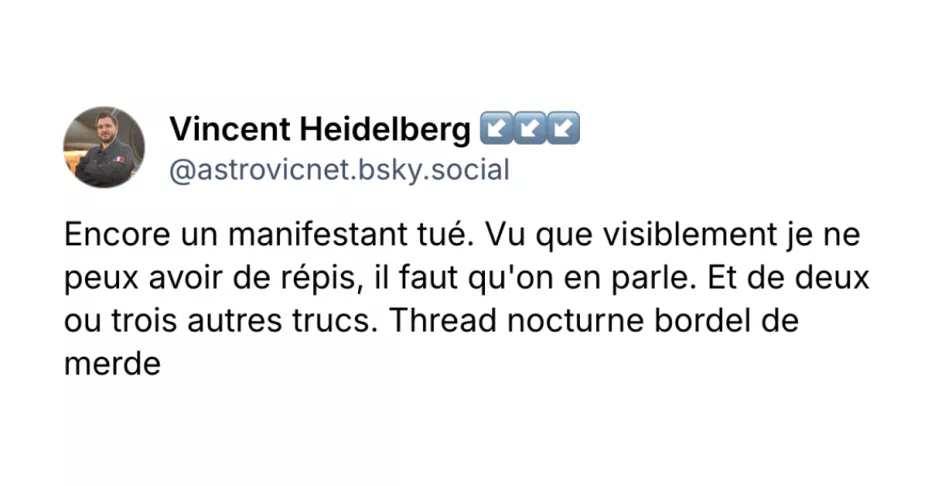
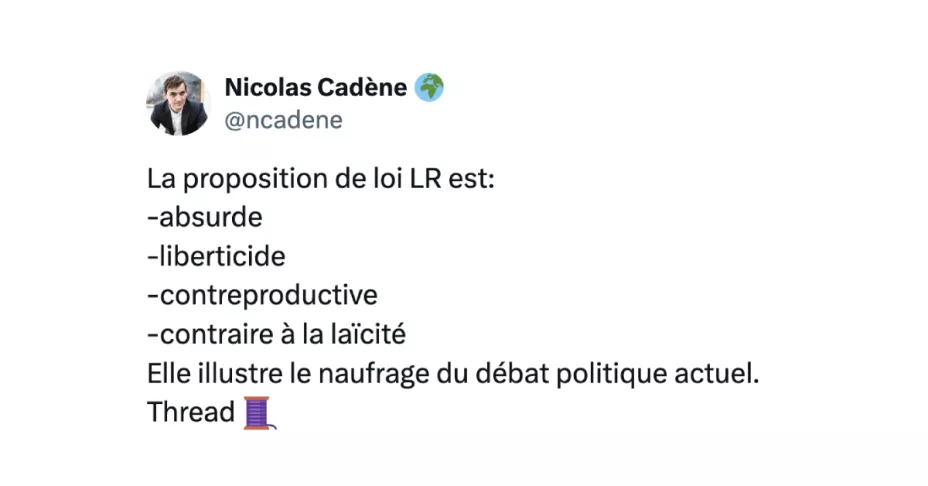
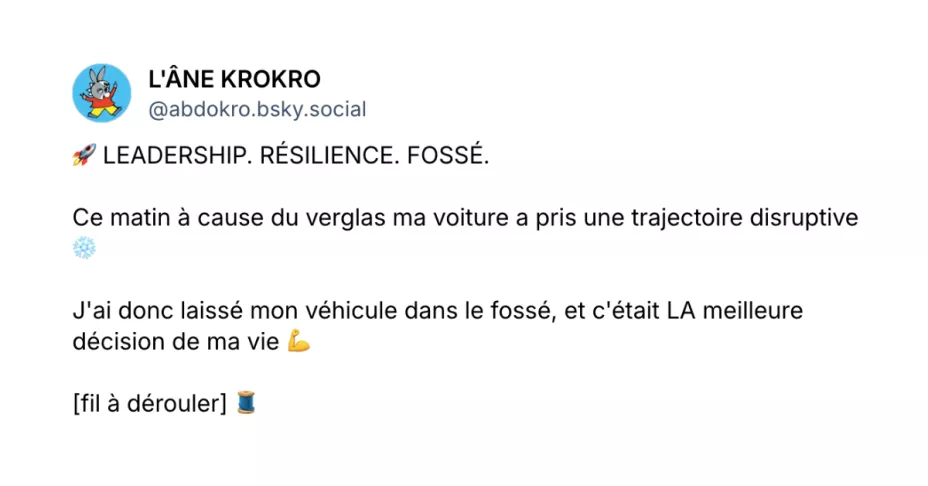
Commentaires 0
Rédigez votre commentaire